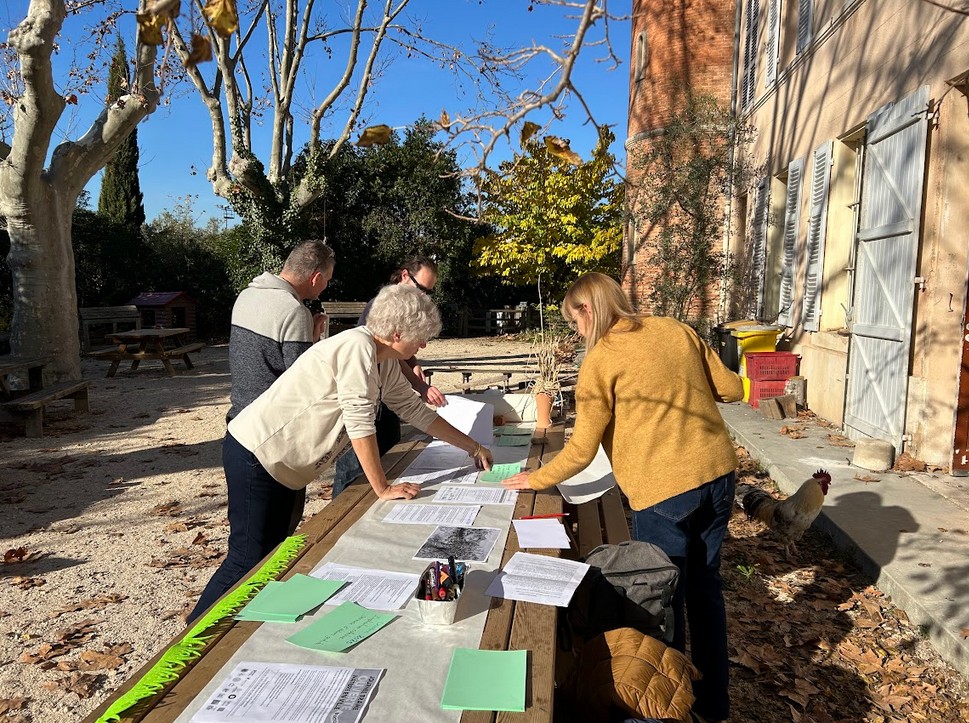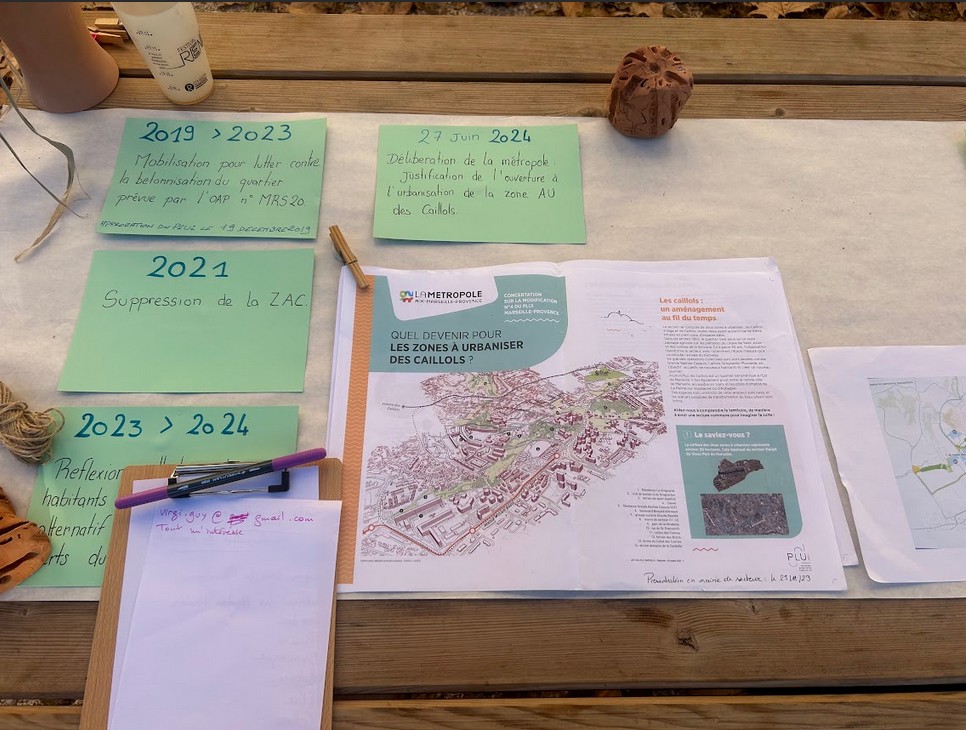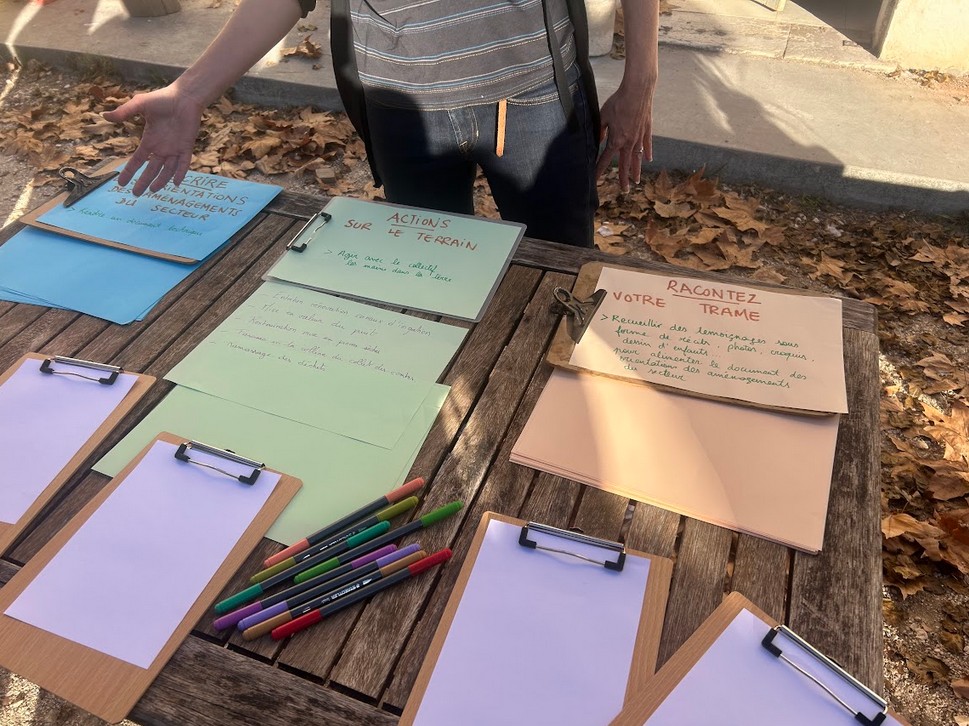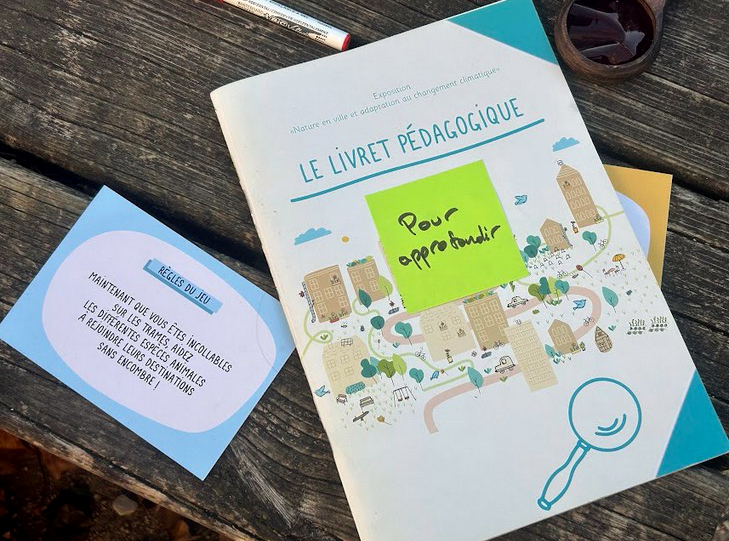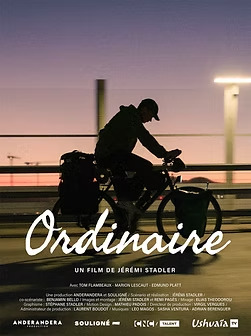Un projet qui existe depuis 1970
« J’ai toujours eu une passion pour la nature depuis mon enfance et j’ai eu l’occasion de développer cette passion par des voyages », raconte Roland de Miller. « J’ai eu aussi des expériences personnelles de communion avec la nature très fortes, marquantes pour le reste de ma vie. » Guidé par cette passion, il s’engage dès ses 16 ans dans la protection de la nature. Il arrive à Paris à 18 ans et cherche à se documenter sur l’écologie et sur les associations existantes. En plus de sa vie universitaire, il trouve un emploi de documentaliste au service de la conservation de la nature au Musée National d’Histoire Naturelle de Paris. En parallèle, il s’engage dans la vie militante et s’investit au sein de plusieurs associations.
1970 est une date importante. Elle est proclamée Année Européenne de la conservation de la nature par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. L’écologie gagne alors en visibilité et acquiert une place plus importante dans l’espace public, les médias et l’éducation.
C’est dans ce contexte que le chercheur décide de créer sa bibliothèque. constituée au départ de quelques milliers de livres, la collection en compte vite des dizaines de milliers. « En France et à l’étranger, j’essayais de surveiller le développement de l’écologie et de la protection de la nature. » Il accumule d’abord des ouvrages pour lui, mais dans l’idée de constituer un centre de documentation national sur l’environnement.
Quand il arrive en Provence en 1981, il établit des réseaux dans les différents départements et se bâtit une réputation d’ “expert de la nature”, en développant un large réseau de militants et de chercheurs. En 2008, il est officiellement reconnu comme libraire sur les marchés, les foires et sur internet. Ce statut lui permet d’élargir encore son réseau et de récupérer des ouvrages auprès de particuliers. En 58 ans de recherches, il a réussi à réunir plus de 50 000 livres, plus de 1000 périodiques et 700 affiches écologistes. Un fonds unique, structuré en quatre grandes divisions (Nature et sciences naturelles / Environnement et aménagement / Santé, culture, littérature et philosophie / Peuples et cultures du monde) et 74 thèmes.
Une bibliothèque qui risque de disparaître
La collection de Roland de Miller, comme le clame le site de la Bibliothèque de l’Écologie, « devrait être reconnue comme d’intérêt public et national ». Depuis plus de 5 ans, déclare-t-il, il est en pourparlers avec la ville de Marseille, mais les obstacles s’accumulent. Aujourd’hui, ses livres sont stockés dans plusieurs garages à Gap, dans les Hautes-Alpes. Des frais qu’il ne parvient plus à assumer. « Je ne vais pas bien, j’ai des soucis d’argent à cause de la bibliothèque. J’ai perdu, ces dernières années, des dizaines de milliers d’euros, je suis à bout, je n’ai plus d’argent, je suis à sec », confie-t-il.
Les démarches administratives prennent énormément de temps, et les scientifiques qu’il contacte ne lui répondent pas, déplore Roland de Miller. Il a notamment écrit à l’Université d’Aix-Marseille, en proposant de créer un programme culturel lié à sa bibliothèque de l’écologie, sans réponse pour le moment. En attendant, il cherche un lieu provisoire pour faire venir le fonds. Si aucune solution n’est trouvée rapidement, les livres sont amenés à disparaître. « On ne se rend pas compte du trésor qu’ils représentent, cela mérite d’être mis en valeur », insiste-t-il.
L’objectif de sa bibliothèque est d’être au service de la collectivité, utile aux étudiants, universitaires (naturalistes, botanistes, zoologistes, écologues, océanographes, sociologues, historiens, philosophes, éthiciens, psychologues, géographes…), mais aussi aux professions médicales, journalistes, écrivains, artistes, architectes…. Elle serait ouverte au public et aux scientifiques et pourrait, selon le chercheur, « créer du tourisme culturel ».
Il est entouré par plusieurs collaborateurs et collaboratrices, souvent des retraités, qui l’aident dans ses démarches, basés dans les Alpes, la Drôme ou plus loin encore. Wildproject, maison d’édition marseillaise axée sur l’écologie, a publié début février un communiqué de presse appelant à le soutenir : l’objectif prioritaire étant de trouver un lieu de stockage vacant de 250 m² pour accueillir 110 palettes d’ouvrages. Gilles Marcel, président de France Nature Environnement Paca, estime que « ce qui bloque, ce sont les frais, car des lieux, il n’en manque pas ; mais les adapter pour recevoir du public, embaucher, représente un coût difficile à mobiliser en période de restrictions budgétaires ». Lui-même pourrait jouer un rôle de facilitateur, et FNE Paca apporter une aide logistique et technique au projet de créer une association pour la préfiguration et le développement de la bibliothèque.
Un trésor culturel inestimable pour la société
« Sans la lecture et la culture, la société s’effrite », regrette Roland de Miller, qui a le sentiment d’être entravé dans sa démarche faute d’intérêt pour les livres. Pour lui, l’éducation à l’écologie est essentielle à notre société. Il raconte avoir vu, en 50 ans, les discours sur l’écologie se brouiller et la difficulté de maintenir la vérité. « Aujourd’hui, beaucoup prétendent défendre l’écologie, mais font tout le contraire. »
Il dit avoir l’impression que, depuis plusieurs années, on ne veut plus lui faire de la place en France, ou alors, uniquement de façon marginale. « On doit reconnaître la maturité de l’écologie dans la société française et européenne. Il semble qu’aujourd’hui, on veut la mettre au placard, on l’accuse de tous les crimes. L’écologie n’a pas le vent en poupe en ce moment, et c’est regrettable. »
À presque 80 ans, Roland de Miller continue de se battre pour continuer à faire vivre le trésor qu’il a constitué toute sa vie. Reste à savoir si une solution concrète arrivera à temps, avant que ce patrimoine unique ne disparaisse.
Célia Horvath, le 18 février 2026