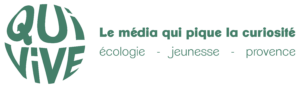Pacification de la montagne
En rando, on voit parfois de gros chiens blancs, très impressionnants, qui surveillent les troupeaux, notamment contre les loups. Les contourner, éviter le contact ? Pas facile de savoir comment s’y prendre. Le programme Alpatous, porté par France Nature Environnement (FNE), vise à apaiser les tensions entre usagers de la montagne, où la présence du prédateur les exacerbe. Rencontre avec une coordinatrice du dispositif.
Voulez-vous vous présenter, et nous dire quelles sont vos fonctions ?
Je m’appelle Justine Poncet. Salariée de France Nature Environnement dans les Alpes de Haute-Provence, je suis coordinatrice de l’association, mais je aussi chargée de projets. Notamment du programme Alpatous, qui se déploie au niveau régional en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et désormais en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).
En quoi consiste ce programme Alpatous ?
C’est une formation, sur deux jours, de bénévoles qui souhaitent s’investir pour la cohabitation avec le loup. Elle est mise en place depuis 2021, avec la participation de l’État, l’Office français de la biodiversité et la DTT, mais aussi le monde agricole avec l’Institut de l’élevage et le CERPAM. Cela nous tient à cœur que chacun soit représenté, avec tous les sons de cloche, pour que la parole soit transparente et la plus impartiale possible.
À l’issue de ces deux jours, qu’est-ce qu’on demande aux bénévoles ?
C’est d’aller sensibiliser le plus de monde possible aux gestes à adopter face aux chiens de protection, qu’on appelle souvent patous, même s’il existe d’autres espèces. Ils sont relativement nouveaux sur le territoire, parce qu’ils constituent l’un des meilleurs moyens de protection contre le loup [ revenu en 1993 par les Alpes, ndlr ]. Les usagers de la montagne n’en ont pas encore l’habitude et parfois, leur présence engendre des conflits, des tensions. Donc ils vont aller expliquer comment faire pour que ça se passe bien avec ces chiens-là, qui peuvent faire peur.
Ils vont à la rencontre des promeneurs ?
Cela peut être, effectivement, sur leur temps de randonnée, ou bien lors de projections, débats, s’ils tiennent des stands, voire sur un parking, au début d’un sentier, sur un point de vue. Ils décident. Nous aussi, salariés, effectuons des sensibilisations. Nous sommes en lien avec le plus de partenaires possibles, pour être complémentaires : Ferus, WWF, les parcs régionaux, nationaux, les collectivités, etc.. On reste en lien, on se tient informés, pour aller là où les besoins se font sentir.
Comment les bénévoles peuvent-ils faire pour s’engager ?
Ils contactent n’importe quelle antenne de France Nature Environnement, qui va les orienter vers la bonne personne, en charge du programme Alpatous. Ils peuvent s’inscrire, c’est totalement gratuit. Nous leur demandons au moins une sensibilisation par an, quand ils le peuvent.
Par qui ce programme est-il financé ?
Nous allons chercher des financements tous les ans, on se bat ! On a réussi à le lancer en 2021 grâce à la Fondation Albert II de Monaco. Ensuite, d’autres fondations nous ont suivis. Cette année, on a la Poule Rousse et Patagonia. On a eu aussi 1% pour la planète et Terre d’Oc. Bref, pour l’instant, c’est surtout grâce au privé que ça vit.
Pas de soutiens publics ?
Désormais, la DREAL AURA nous suit, parce que c’est eux qui ont la compétence sur le loup et pas la DREAL PACA. Nous espérons que ce partenariat public s’amplifie, parce que maintenant, on organise des formations dans chacune des deux régions, pour que toutes les Alpes françaises soient couvertes par le programme Alpatous.
Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, parle de revenir sur le statut d’espèce protégée du loup. Qu’en pensez-vous ?
Je trouve cela vraiment minable, parce que la motivation de cette dame, c’est son poney qui s’est fait manger. D’un coup, elle a découvert une problématique et a lancé toute une opération qui, démagogiquement parlant, a peut-être un intérêt, mais qui, sur le terrain, ne changera pas grand-chose. Il y a déjà des dérogations sur la destruction d’espèces protégées concernant le loup. Alors, qu’est-ce que cela changera pour les éleveurs, pour les bergers en montagne qui se font prédater la nuit, le jour, leurs troupeaux ? Rien, parce qu’on ne va pas l’éradiquer, il est là pour rester. Par contre, cela affaiblira la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
Comment se passent les choses au niveau national ?
On pourrait espérer qu’on ne refasse pas les mêmes erreurs qu’au retour du loup dans les années 90-2000. Il a été très mal accompagné, les éleveurs ont un peu été laissés tout seuls face à cette prédation. Aujourd’hui, sur les « fronts de recolonisation », on pourrait se dire « bon, on sait à peu près comment faire, ou ce qu’il ne faut pas faire, formons-les, mettons en place tout ce qu’il faut ». Mais ce n’est pas vraiment ce qu’il se passe ! Ou alors très anecdotiquement, grâce à des associations, quelques collectifs pastoraux ou même des syndicats agricoles parfois. Mais ce n’est pas du tout politiquement et publiquement structuré, avec une volonté et des moyens.
L’expérience n’a pas servi.
Oui, et c’est extrêmement dommage parce qu’on attend que ça se passe mal sur les fronts de recolonisation, que les gens s’énervent, et on recommence un peu plus loin les mêmes erreurs !
Le dialogue s’est durci entre pro et anti-loups ?
Jusqu’en 2017, 2018, FNE pouvait pas mal discuter avec différents collectifs, syndicats, représentants agricoles, sur nombre de sujets. Après, ça s’est fortement tendu, à cause du loup. Dans des instances qui avaient rien à voir, par exemple sur les questions relatives à l’eau, l’alimentation, les pesticides, on était considérés comme pro-loup, donc certains refusaient de parler avec nous. Cela fermait le dialogue absolument sur tout.
Est-ce que cela évolue tout de même ?
Grâce à Alpatous, et pour plein d’autres raisons, on réussit à renouer le dialogue au fur et à mesure en montrant qu’en fait, à d’autres endroits, ça se passe bien. Enfin, nous, on n’en a jamais douté une seule seconde de l’importance de se parler ! Ce n’est pas encore super détendu, mais cela va dans le bon sens.
Vous gardez espoir ?
Oui, je ne serais pas dans une association comme FNE, si je n’avais plus d’espoir ! Je pense qu’un jour, cela s’apaisera d’une façon ou d’une autre, même s’il y aura toujours des points de désaccord. Mais avec les nouvelles générations d’éleveurs, de bergers, avec les retours d’expérience, avec la faculté qu’a le loup de recoloniser ses espaces naturels, de s’adapter… Je pense que ça va beaucoup, beaucoup aider parce qu’à un moment, il sera partout en France. Et on vivra avec lui, d’une façon ou d’une autre ; tout le monde vivra avec lui.
Les populations de loups se régulent elles-mêmes, selon les scientifiques.
Tout à fait, sa population se régule naturellement, par deux facteurs. Le premier étant le nombre de proies disponibles. La majorité de son régime alimentaire, quand on étudie les déjections, est constituée de proies sauvages, des ongulés essentiellement, des sangliers… Si elles ne sont pas assez nombreuses, il va ailleurs. Ensuite, il ne peut pas y avoir trop de loups en rivalité sur un territoire ; les jeunes se dispersent, et une auto-régulation des naissances survient. Cela fonctionne pour le loup comme pour plein d’autres grands prédateurs, leur surpopulation est impossible.
Qu’est-ce qui motive vos bénévoles ?
Il faudrait le leur demander ! En tout cas, de ce que je sais, la première entrée quand ils viennent vers nous est la protection du loup. Ensuite, avec la formation, et c’est pour ça qu’on invite cette diversité d’acteurs, ils se rendent compte de la complexité du sujet. Ils comprennent les problématiques de l’élevage face à la prédation, ce que cela change du métier, ce qu’on demande à la société. Ils nous disent « moi aussi je dois faire ma part, puisque je veux que le loup soit présent, je veux le retour de la biodiversité, donc je vais participer, faire des efforts pour que la charge ne repose pas exclusivement sur le berger, l’éleveur ou l’agent de l’Office français de la biodiversité ». Les usagers de la montagne qui sont là pour leurs loisirs et qui parfois sont contraints, par la présence des patous, doivent aussi être entendus.
Il semble que vous n’ayez pas de mal à trouver des éleveurs pour vous accueillir avec vos bénévoles. Mais quelles sont les relations avec les chasseurs ?
Il n’y en a pas. Parce que les seuls moments de rencontre sont les commissions de la chasse et de la faune sauvage, donc évidemment pas les lieux les plus propices au dialogue constructif. Chacun a des choses à défendre, souvent contradictoires. Est-ce que personne n’a envie de se rapprocher ? Je ne sais pas. En tout cas nous n’avons pas de projets qui demandent à ce qu’on soit en lien. Peut-être plus tard, qui sait, nous on n’est jamais fermés, donc si on nous assure qu’il puisse y avoir du dialogue et qu’on s’écoute, avec grand plaisir.
Propos recueillis par Gaëlle Cloarec,
le 9 avril 2024